Véretz le 16 juillet 1822
 our avoir écrit le Simple discours, Courier purgea deux mois de prison à Sainte-Pélagie d’où il sortit le 9 décembre 1821. Dans l’esprit des juges, cette semonce allait l’amener à modérer ses attaques contre la Restauration. C’était mal connaître le « bonhomme Paul » prêt à « fronder un petit » à la première occasion. Le 10 mai 1822 eut lieu l’élection du député de l’arrondissement de Loches-Chinon. Courier fut le candidat, bien malgré lui, de l’opposition contre le candidat officiel le comte Armand de Ruzé, d’Effiat1 . Sans faire campagne, Courier obtint 133 voix. Il fut raillé par le Drapeau blanc, journal légitimiste mais lui répondit avec son ironie coutumière dans le Courrier français.
our avoir écrit le Simple discours, Courier purgea deux mois de prison à Sainte-Pélagie d’où il sortit le 9 décembre 1821. Dans l’esprit des juges, cette semonce allait l’amener à modérer ses attaques contre la Restauration. C’était mal connaître le « bonhomme Paul » prêt à « fronder un petit » à la première occasion. Le 10 mai 1822 eut lieu l’élection du député de l’arrondissement de Loches-Chinon. Courier fut le candidat, bien malgré lui, de l’opposition contre le candidat officiel le comte Armand de Ruzé, d’Effiat1 . Sans faire campagne, Courier obtint 133 voix. Il fut raillé par le Drapeau blanc, journal légitimiste mais lui répondit avec son ironie coutumière dans le Courrier français.
Sur ces entrefaites, l’occasion de porter une nouvelle attaque contre le régime se présenta sous les traits d’un jeune curé qui… mais pour comprendre toute l’affaire, comme au cinéma, pratiquons un flash-back.
L’abbé Guerry, brave homme et habitué à ses ouailles, laissait depuis toujours ses paroissiens d’Azay-sur-Cher danser le dimanche et les jours de fête religieuse, tout comme son collègue de Véretz. Sur décision de l’archevêque de Tours, il fut muté à Cormery. Son remplaçant, l’abbé Bruneau, frais sorti du séminaire et qui avait été quelques mois vicaire à Chinon était déterminé à en découdre avec le paganisme et l’irrespect de la religion. Il fut solennellement installé dans sa cure le dimanche 21 octobre 1821.
Les rapports entre la commune et lui se dégradèrent très vite. Une nuit, on chanta sous sa fenêtre des chansons à ne pas mettre dans toutes les oreilles. Il s’en offusqua et, mesure de rétorsion, demanda au préfet que soit interdite la danse le dimanche. Le représentant du roi d’obtempérer et la maréchaussée de se faire omniprésente, au risque de mécontenter toute la communauté du village. On imagine la chaude ambiance dans la paroisse.
Courier tire bénéfice de la situation et dénonce cette mesure avec une férocité de velours qui lui permettra finalement d’échapper à toute poursuite judiciaire mais non aux tracas et persécutions ; pendant une de ses absences, la police passe au peigne fin la Chavonnière, en présence d’Herminie, pour confisquer les exemplaires qui s’y trouveraient de la Pétition pour des villageois qu’on empêche de danser sortie des presses mi-juillet 1822.
Menacé d’une sanction pire que celle infligée lors de son précédent procès (13 mois de prison et 3000 francs d’amende !), Courier s’en tirera bien : les juges ne trouveront aucun motif de poursuite à ce pamphlet et il sera relaxé.
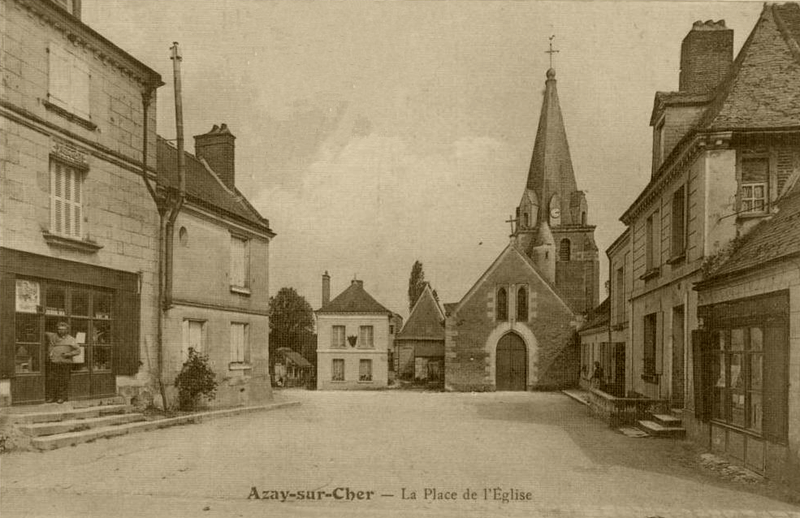 La place de l'église d'Azay-sur-cher
La place de l'église d'Azay-sur-cher
 'objet de ma demande est plus important qu'il ne semble ; car bien qu'il ne s'agisse, au vrai, que de danse et d'amusements, comme d'une part ces amusements sont ceux du peuple, et que rien de ce qui le touche ne vous peut être indifférent ; que d'autre part, la religion s'y trouve intéressée ou compromise, pour mieux dire, par un zèle mal entendu, je pense, quelque peu d'accord qu'il puisse y avoir entre vous, que tous vous jugerez ma requête digne de votre attention.
'objet de ma demande est plus important qu'il ne semble ; car bien qu'il ne s'agisse, au vrai, que de danse et d'amusements, comme d'une part ces amusements sont ceux du peuple, et que rien de ce qui le touche ne vous peut être indifférent ; que d'autre part, la religion s'y trouve intéressée ou compromise, pour mieux dire, par un zèle mal entendu, je pense, quelque peu d'accord qu'il puisse y avoir entre vous, que tous vous jugerez ma requête digne de votre attention.
Je demande qu'il soit permis, comme par le passé, aux habitants d'Azai de danser le dimanche sur la place de leur commune, et que toutes défenses faites, à cet égard, par le préfet, soient annulées.
Nous y sommes intéressés, nous gens de Véretz, qui allons aux fêtes d'Azai, comme ceux d'Azai viennent aux nôtres. la distance des deux clochers n'est que d'une demi-lieue environ : nous n'avons point de plus proches ni de meilleurs voisins. Eux ici, nous chez eux, on se traite tour à tour, on se divertit le dimanche, on danse sur la place, après midi, les jours d'été. Après midi viennent les violons et les gendarmes en même temps ; sur quoi j'ai deux remarques à faire.
Nous dansons au son du violon ; mais ce n'est que depuis une certaine époque. Le violon était réservé jadis aux bals des honnêtes gens ; car d'abord il fut rare en France. Le grand roi fit venir des violons d'Italie, et en eut une compagnie pour faire danser sa cour gravement, noblement, les cavaliers en perruque noire, les dames en vertugadin. Le peuple payait ces violons, mais ne s'en servait pas ; dansait peu, quelquefois au son de la musette ou cornemuse, témoin ce refrain :
Voici le pèlerin jouant de sa musette : danse, Guillot ; saute, Perrette. Nous, les neveux de ces Guillots et de ces Perrettes, quittant les façons de nos pères, nous dansons au son du violon, comme la cour de Louis le Grand. Quand je dis comme, je m'entends ; nous ne dansons pas gravement, ni ne menons, avec nos femmes, nos maîtresses et nos bâtards. C'est là la première remarque ; l'autre, la voici :
Les gendarmes se sont multipliés en France ; bien plus encore que les violons, quoique moins nécessaires pour la danse. Nous nous en passerions aux fêtes du village, et à dire vrai ce n'est pas nous qui les demandons : mais le gouvernement est partout aujourd'hui, et cette ubiquité s'étend jusqu'à nos danses, où il ne se fait pas un pas dont le préfet ne veuille être informé, pour en rendre compte au ministre.
De savoir à qui tant de soins sont plus déplaisants, plus à charge, et qui en souffre davantage, des gouvernants ou de nous gouvernés, surveillés, c'est une grande question et curieuse, mais que je laisse à part, de peur de me brouiller avec les classes, ou de dire quelque mot tendant à je ne sais quoi.
Outre ces danses ordinaires les dimanches et fêtes, il y a ce qu'on nomme l'assemblée une fois l'an, dans chaque commune, qui reçoit à son tour les autres. Grande affluence ce jour-là, grande joie pour les jeunes gens. Les violons n'y font faute, comme vous pouvez croire. Au premier coup d'archet, on se place, et chacun mène sa prétendue. Autre part on joue à des jeux que n'afferme point le Gouvernement : au palet, à la boule, aux quilles. Plusieurs, cependant, parlent d'affaires ;
des marchés se concluent, mainte vache est vendue qui n'avait pu l'être à la foire. Ainsi ces assemblées ne sont pas des rendez-vous de plaisir seulement, mais touchent les intérêts du public et de chacun, et le lieu où elles se tiennent n'est pas non plus indifférent. La place d'Azai semble faite exprès pour cela ; située au centre de la commune, en terrain battu, non pavé, par là propre à toutes sortes de jeux et d'exercices ;
entourée de boutiques, à portée des hôtelleries, des cabarets ; car peu de marchés se font sans boire, peu de contredanses se terminent sans vider quelques pots de bière ; nul désordre, jamais l'ombre d'une querelle. C'est l'admiration des Anglais, qui nous viennent voir quelquefois, et ne peuvent quasi comprendre que nos fêtes populaires se passent avec tant de tranquillité, sans coups de poing comme chez eux, sans meurtres comme en Italie, sans ivres-morts comme en Allemagne.
Le peuple est sage, quoi qu'en disent les notes secrètes2. Nous travaillons trop pour avoir le temps de penser à mal ; et s'il est vrai, ce mot ancien, que tout vice naît d'oisiveté, nous devons être exempts de vices, occupés comme nous le sommes six jours de la semaine sans relâche, et bonne part du septième, chose que blâment quelques-uns.
Ils ont raison, et je voudrais que ce jour-là toute besogne cessât ;
il faudrait, dimanches et fêtes, par tous les villages s'exercer au tir, au maniement des armes, penser aux puissances étrangères, qui pensent à nous tous les jours. Ainsi font les Suisses nos voisins, et ainsi devrions-nous faire, pour être gens à nous défendre en cas de noise avec les forts. Car de se fier au ciel et à notre innocence, il vaut bien mieux apprendre la charge en douze temps, et savoir au besoin ajuster un Cosaque.
Je l'ai dit et le redis : labourer, semer à temps, être aux champs dès le matin, ce n'est pas tout : il faut s'assurer la récolte. Aligne tes plants, mon ami, tu provigneras l'an qui vient, et quelque jour, Dieu aidant, tu feras du bon vin. Mais qui le boira ? Rostopchin3, si tu ne te tiens prêt à le lui disputer. Vous, messieurs, songez-y pendant qu'il en est temps : avisez entre vous s'il ne vous conviendrait pas, vu les circonstances présentes ou imminentes,
de vaquer le saint jour du dimanche, sans préjudice de la messe, à des exercices qu'approuve le Dieu des armées, tels que le pas de charge et les feux de bataillon. Ainsi pourrions-nous employer, avec très grand profit pour l'État et pour nous, des moments perdus à la danse.
Nos dévots toutefois l'entendent autrement. Ils voudraient que, ce jour-là, on ne fît rien du tout que prier et dire ses heures. C'est la meilleure chose et la seule nécessaire, l'affaire du salut. Mais le percepteur est là ; il faut payer et travailler pour ceux qui ne travaillent point. Et combien pensez-vous qu'ils soient à notre charge ? enfants, vieillards, mendiants, moines, laquais, courtisans ; que de gens à entretenir, et magnifiquement la plupart !
Puis, la splendeur du trône, et puis la Sainte-Alliance ; que de coûts, quelles dépenses ! et pour y satisfaire, a-t-on trop de tout son temps ? Vous le savez d'ailleurs et le voyez, messieurs ; ceux qui haïssent tant le travail du dimanche veulent des traitements, envoient des garnisaires, augmentent le budget. Nous devons chaque année, selon eux, payer plus et travailler moins.
Mais quoi ? la lettre tue et l'esprit vivifie4. Quand l'Église a fait ce commandement de s'abstenir à certains jours de toute œuvre servile, il y avait des serfs alors liés à la glèbe ; pour eux, en leur faveur, le repos fut prescrit ; alors il n'était saint que la gent corvéable ne chômât volontiers ; le maître seul y perdait, obligé de les nourrir, qui, sans cela, les eût accablés de travail ;
le précepte fut sage et la loi salutaire dans ces temps d'oppression. Mais depuis qu'il n'y a plus ni fiefs, ni haubert ; qu'affranchis, peu s'en faut, de l'antique servitude, nous travaillons pour nous quand l'impôt est payé, nous ne saurions chômer qu'à nos propres dépens ; nous y contraindre, c'est… c'est pis que le budget, car le budget du moins profite aux courtisans, mais notre oisiveté ne profite à personne.
Le travail qu'on nous défend, ce qu'on nous empêche de faire, le vivre et le vêtement qu'on nous ôte par là, ne produisent point de pensions, de grâces, de traitements : c'est nous nuire en pure perte.
Les Anglais, en voyant nos fêtes, montrent tous la même surprise, font tous la même réflexion ; mais, parmi eux, il y en a qu'elles étonnent davantage : ce sont les plus âgés qui, venus en France autrefois, ont quelque mémoire de ce qu'était la vieille Touraine et le peuple des bons seigneurs. De fait, il m'en souvient : jeune alors, j'ai vu, avant cette grande époque où soldat volontaire de la révolution,
j'abandonnai des lieux si chers à mon enfance, j'ai vu les paysans affamés, déguenillés, tendre la main aux portes et partout sur les chemins, aux avenues des villes, des couvents, des châteaux, où leur inévitable aspect était le tourment de ceux-là même que la prospérité commune indigne, désole aujourd'hui. La mendicité renaît, je le sais, et va faire, si ce qu'on dit est vrai, de merveilleux progrès,
mais n'atteindra de longtemps ce degré de misère. Les récits que j'en ferais seraient faibles pour ceux qui l'ont vue comme moi ; aux autres, sembleraient inventés à plaisir ; écoutez un témoin, un homme du grand siècle, observateur exact et désintéressé ; son dire ne peut être suspect, c'est la Bruyère.
« On voit », dit-il, « certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus dans la campagne, noirs, livides, nus et tout brûlés du soleil, attachés à la terre, qu'ils fouillent et remuent avec une opiniâtreté invincible. Ils ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine, et en effet ils sont des hommes ;
ils se retirent la nuit dans des tanières, où ils vivent de pain noir, d'eau et de racines. Ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé5. »
Voilà ses propres mots ; il parle des heureux, de ceux qui avaient du pain, du travail ; et c'était le petit nombre alors.
Si la Bruyère pouvait revenir, comme on revenait autrefois, et se trouver à nos assemblées, il y verrait non seulement des faces humaines, mais des visages de femmes et de filles plus belles, surtout plus modestes que celles de sa cour tant vantée, mises de meilleur goût sans contredit, parées avec plus de grâce, de décence, dansant mieux, parlant la même langue (chose particulière au pays), mais d'une voix si joliment, si doucement articulée, qu'il en serait content, je crois.
Il les verrait le soir se retirer, non dans des tanières, mais dans leurs maisons proprement bâties et meublées. Cherchant alors ces animaux dont il a fait la description, il ne les trouverait nulle part, et sans doute bénirait la cause, quelle qu'elle soit, d'un si grand, si heureux changement.
Les fêtes d'Azai étaient célèbres entre toutes celles de nos villages, attiraient un concours de monde des champs, des communes d'alentour. En effet, depuis que les garçons, dans ce pays, font danser les filles, c'est-à-dire depuis le temps que nous commençâmes d'être à nous6, paysans des rives du Cher, la place d'Azai fut toujours notre rendez-vous de préférence pour la danse et pour les affaires.
Nous y dansions comme avaient fait nos pères et nos mères, sans que jamais aucun scandale, aucune plainte en fût avenue, de mémoire d'homme ; et ne pensions guère, sages comme nous sommes, ne causant aucun trouble, devoir être troublés dans l'exercice de ce droit antique, légitime, acquis et consacré par un si long usage, fondé sur les premières lois de la raison et du bon sens, car, apparemment,
c'est chez soi qu'on a droit de danser : et où le public sera-t-il, sinon sur la place publique ? On nous en chasse néanmoins. Un firman du préfet, qu'il appelle arrêté, naguère publié, proclamé au son du tambour, Considérant, etc., défend de danser à l'avenir, ni jouer à la boule ou aux quilles, sur ladite place, et ce, sous peine de punition. Où dansera-t-on ? nulle part ; il ne faut point danser du tout.
Cela n'est pas dit clairement dans l'arrêté de M. le préfet ; mais c'est un article secret entre lui et d'autres puissances, comme il a bien paru depuis. On nous signifia cette défense quelques jours avant notre fête, notre assemblée de la Saint-Jean.
Le désappointement fut grand pour tous les jeunes gens, grand pour les marchands en boutique, et autres qui avaient compté sur quelque débit. Qu'arriva-t-il ? la fête eut lieu, triste, inanimée, languissante ; l'assemblée se tint, peu nombreuse, et comme dispersée çà et là. Malgré l'arrêté, on dansa hors du village, au bord du Cher, sur le gazon, sous la coudrette ;
cela est bien plus pastoral que les échoppes du marché, de meilleur effet dans une églogue, et plus poétique en un mot. Mais chez nous, gens de travail, c'est de quoi on se soucie peu ; nous aimons mieux, après la danse, une omelette au lard, dans le cabaret prochain que le murmure des eaux et l'émail des prairies.
Nos dimanches d'Azai, depuis lors, sont abandonnés. Peu de gens y viennent de dehors, et aucun n'y reste. On se rend à Véretz, où l'affluence est grande, parce que là nul arrêté n'a encore interdit la danse. Car le curé de Véretz est un homme sensé, instruit, octogénaire quasi7,
mais ami de la jeunesse, trop raisonnable pour vouloir la réformer sur le patron des âges passés, et la gouverner par des bulles de Boniface ou d'Hildebrand8.
C'est devant sa porte qu'on danse, et devant lui le plus souvent. Loin de blâmer ces amusements, qui n'ont rien en eux-mêmes que de fort innocent, il y assiste, et croit bien faire, y ajoutant par sa présence, et le respect que chacun lui porte, un nouveau degré de décence et d'honnêteté. Sage pasteur, vraiment pieux, le puissions-nous longtemps conserver pour le soulagement du pauvre, l'édification du prochain et le repos de cette commune, où sa prudence maintient la paix, le calme, l'union, la concorde.
Le curé d'Azai, au contraire, est un jeune homme bouillant de zèle, à peine sorti du séminaire, conscrit de l'Église militante, impatient de se distinguer. Dès son installation, il attaque la danse, et semble avoir promis à Dieu de l'abolir dans sa paroisse, usant pour cela de plusieurs moyens, dont le principal et le seul efficace, jusqu'à présent, est l'autorité du préfet. Par le préfet,
il réussit à nous empêcher de danser, et bientôt nous fera défendre de chanter et de rire. Bientôt ! que dis-je ? il y a eu de nos jeunes gens mandés, menacés, réprimandés pour des chansons, pour avoir ri. Ce n'est pas, comme on sait, d'aujourd'hui que les ministres de l'Église ont eu la pensée de s'aider du bras séculier dans la conversion des pécheurs, où
les apôtres n'employaient que l'exemple et la parole, selon le précepte du maître. Car Jésus avait dit : Allez et instruisez. Mais il n'avait pas dit : Allez avec des gendarmes, instruisez de par le préfet ; et depuis, l'Ange de l'école, saint Thomas, déclara nettement qu'on ne doit pas contraindre à bien faire. On ne nous contraint pas, il est vrai ; on nous empêche de danser.
Mais c'est un acheminement ; car les mêmes moyens, qui sont bons pour nous détourner du péché, peuvent servir et serviront à nous décider aux bonnes œuvres. Nous jeûnerons par ordonnance, non du médecin mais du préfet.
Et ce que je viens de vous dire n'a pas lieu chez nous seulement. Il en est de même ailleurs, dans les autres communes de ce département où les curés sont jeunes. A quelques lieues d'ici, par exemple à Fondettes, delà les deux rivières de la Loire et du Cher, pays riche, heureux, où l'on aime le travail et la joie autant pour le moins que de ce côté, toute danse est pareillement défendue aux administrés par un arrêté du préfet.
Je dis toute danse sur la place, où les fêtes amenaient un concours de plusieurs milliers de personnes des villages environnants et de Tours, qui n'en est qu'à deux lieues. Les hameaux près de Paris, les bastides de Marseille, au dire des voyageurs, avec plus d'affluence, en gens de ville surtout, avaient moins d'agrément, de rustique gaieté. N'en soyez plus jaloux, bals champêtres de Sceaux et du pré Saint-Gervais :
ces fêtes ont cessé, car le curé de Fondettes est aussi un jeune homme sortant du séminaire, comme celui d'Azai du séminaire de Tours, maison dont les élèves, une fois en besogne dans la vigne du Seigneur, en veulent extirper d'abord tout plaisir, tout divertissement, et faire d'un riant village un sombre couvent de la Trappe9. Cela s'explique : on s'explique tout dans le siècle où nous sommes ; jamais le monde n'a tant raisonné sur les effets et sur les causes.
Le monde dit que ces jeunes prêtres, au séminaire, sont élevés par un moine, un frère picpus10, frère Isidore, c'est son nom ; homme envoyé des hautes régions de la monarchie, afin d'instruire nos docteurs, de former les instituteurs qu'on destine à nous réformer. Le moine fait les curés, les curés nous feront moines. Ainsi l'horreur de ces jeunes gens pour le plus simple amusement leur vient du triste picpus, qui lui-même tient d'ailleurs sa morale farouche.
Voilà comme en remontant dans les causes secondes on arrive à Dieu, cause de tout. Dieu nous livre aux picpus11. Ta volonté, Seigneur, soit faite en toute chose. Mais qui l'eût dit à Austerlitz ?
Une autre guerre que font à nos danses de village ces jeunes séminaristes, c'est la confession. Ils confessent les filles, sans qu'on y trouve à redire, et ne leur donnent l'absolution qu'autant qu'elles promettent de renoncer à la danse ; à quoi peu d'entre elles consentent, quelque ascendant que doive avoir, et sur le sexe et sur leur âge, un confesseur de vingt-cinq ans, à qui les aveux, le secret et l'intimité qui s'ensuit nécessairement,
donnent tant d'avantages, tant de moyens pour persuader ; mais les pénitentes aiment la danse. Le plus souvent aussi elles aiment un danseur qui, après quelque temps de poursuite et d'amour, enfin devient un mari. Tout cela se passe publiquement : tout cela est bien, et en soi beaucoup plus décent que des conférences tête à tête avec ces jeunes gens vêtus de noir. Y a-t-il de quoi s'étonner que de tels attachements l'emportent sur l'absolution,
et que le nombre des communiants se trouve diminué cette année de plus des trois quarts, à ce qu'on dit ? La faute en est toute au pasteur, qui les met dans le cas d'opter entre ce devoir de religion et les affections les plus chères de la vie présente, montrant bien par là que le zèle pour conduire les âmes ne suffit pas, même uni à la charité. Il y faut ajouter encore la discrétion, dit saint Paul,
aussi nécessaire aujourd'hui, dans ce ministère pieux, qu'elle le fut au temps de l'Apôtre.
En effet, le peuple est sage, comme j'ai déjà dit, plus sage de beaucoup et plus heureux aussi qu'avant la révolution ; mais il faut l'avouer, il est bien moins dévot. Nous allons à la messe le dimanche à la paroisse, pour nos affaires, pour y voir nos amis ou nos débiteurs ; nous y allons : combien reviennent (j'ai grand'honte à le dire) sans l'avoir entendue, partent, leurs affaires faites, sans être entrés dans l'église !
Le curé d'Azai, à Pâques dernier, voulant quatre hommes, pour porter le dais, qui eussent communié, ne les put trouver dans le village ; il en fallut prendre de dehors, tant est rare chez nous et petite la dévotion. En voici la cause, je crois. Le peuple est d'hier propriétaire, ivre encore, épris, possédé de sa propriété ; il ne voit que cela, ne rêve d'autre chose, et, nouvel affranchi de même,
quant à l'industrie, se donne tout au travail, oublie le reste et la religion. Esclave auparavant, il prenait du loisir, pouvait écouter, méditer la parole de Dieu, et penser au ciel, où était son espoir, sa consolation. Maintenant il pense à la terre qui est à lui, et le fait vivre. Dans le présent ni dans l'avenir, le paysan n'envisage plus qu'un champ, une maison qu'il a ou veut avoir, pour laquelle il travaille, amasse, sans prendre repos ni repas.
Il n'a d'idée que celle-là ; et vouloir l'en distraire, lui parler d'autre chose, c'est perdre son temps. Voilà d'où vient l'indifférence, qu'à bon droit nous reproche l'abbé de La Mennais, en matière de religion. Il dit bien vrai ; nous ne sommes pas de ces tièdes que Dieu vomit12, suivant l'expression de Saint Paul ; nous sommes froids, et c'est le pis. C'est proprement le mal du siècle.
Pour y remédier, et nous amener de cette indifférence à la ferveur qu'on désire, il faut user de ménagements, de moyens doux et attrayants ; car d'autres produiraient un effet opposé. La prudence y est nécessaire, ce qu'entendent mal ces jeunes curés, dont le zèle admirable d'ailleurs, n'est pas assez selon la science. Aussi leur âge ne le porte pas.
Pour en dire ici ma pensée, j'écoute peu les déclamations contre la jeunesse d'à présent, et tiens fort suspectes les plaintes qu'en font certaines gens, me rappelant toujours le mot, vengeons-nous par en médire13 (si on médisait seulement ! mais on va plus loin) ; pourtant il doit y avoir du vrai dans ces discours, et je commence à me persuader que la jeunesse séculière, sans mériter d'être sabrée, foulée aux pieds,
ou fusillée, peut ne valoir guère aujourd'hui, puisque même ces jeunes prêtres, dans leurs pacifiques fonctions, montrent de telles dispositions, bien éloignées de la sagesse et de la retenue de leurs anciens. Je vous ai déjà cité, messieurs, notre bon curé de Véretz, qui semble un père au milieu de nous ; mais celui d'Azai, que remplace le séminariste, n'avait pas moins de modération, et s'était fait de même une famille de tous ses paroissiens,
partageant leurs joies, leurs chagrins, leurs peines comme leurs amusements, où de fait on n'eût su que reprendre ; voyant très volontiers danser filles et garçons, et principalement sur la place ; car il l'approuvait là bien plus qu'en quelqu'autre lieu que ce fût, et disait que le mal rarement se fait en public. Aussi trouvait-il à merveille que le rendez-vous des jeunes filles et de leurs prétendus fût sur cette place plutôt qu'ailleurs, plutôt qu'au bosquet ou aux champs,
quelque part loin des regards, comme il arrivera quand nos fêtes seront tout à fait supprimées. Il n'avait garde de demander cette suppression, ni de mettre la danse au rang des péchés mortels, ou de recourir aux puissances pour troubler d'innocents plaisirs. Car, enfin, ces jeunes gens, disait-il, doivent se voir, se connaître avant de s'épouser ; et où se pourraient-ils jamais rencontrer plus convenablement que là,
sous les yeux de leurs amis, de leurs parents et du public, souverain juge en fait de convenance et d'honnêteté ?
Ainsi raisonnait ce bon curé, regretté de tout le pays, homme de bien s'il en fut oncques, irréprochable dans ses mœurs et dans sa conduite, comme sont aussi, à vrai dire, les jeunes prêtres successeurs de ces anciens-là ; car il ne se peut voir rien de plus exemplaire que leur vie. Le clergé ne vit pas maintenant comme autrefois, mais il fait paraître en tout une régularité digne des temps apostoliques. Heureux effet de la pauvreté !
heureux fruit de la persécution soufferte à cette grande époque où Dieu visita son Église ! Ce n'est pas un des moindres biens qu'on doive à la révolution, de voir non seulement les curés, ordre respectable de tout temps, mais les évêques, avoir des mœurs.
Toutefois, il est à craindre que de si excellents exemples, faits pour grandement contribuer au maintien de la religion, ne soient en pure perte pour elle, par l'imprudence des nouveaux prêtres, qui la rendent peu aimable au peuple, en la lui montrant ennemie de tout divertissement, triste, sombre, sévère, n'offrant de tous côtés que pénitence à faire et tourments mérités14, au lieu de prêcher sur des textes plus convenables à présent :
Sachez que mon joug est léger ; ou bien celui-ci : Je suis doux et humble de cœur. On ramènerait ainsi des brebis égarées, que trop de rigueur effarouche. Quelque grands que soient nos péchés, nous n'avons guère maintenant le temps de faire pénitence : il faut semer et labourer. Nous ne saurions vivre en moines, en dévots de profession, dont toutes les pensées se tournent vers le ciel.
Les règles faites pour eux, détachés de la terre, et comme du fumier regardant tout le monde15, ne conviennent point à nous qui avons ici-bas et famille et chevance, comme dit le bonhomme, et malheureusement tenons à toutes ces choses. Puis, que faisons-nous de mal, quand nous ne faisons pas bien, quand nous ne travaillons pas ? Nos délassements, nos jeux, les jours de fête, n'ont rien de blâmable en eux-mêmes, ni par aucune circonstance.
Car ce qu'on allègue au sujet de la place d'Azai, pour nous empêcher d'y danser ; cette place est devant l'église, dit-on ; danser là, c'est danser devant Dieu, c'est l'offenser ; et depuis quand ? Nos pères y dansaient, plus dévots que nous, à ce qu'on nous dit ; nous y avons dansé après eux. Le saint roi David dansa devant l'arche du Seigneur, et le Seigneur le trouva bon ; il en fut aise, dit l'Écriture ;
et nous qui ne sommes saints ni rois, mais honnêtes gens néanmoins, ne pourrons danser devant notre église, qui n'est pas l'arche, mais sa figure, selon les sacrés interprètes ! Ce que Dieu aime de ses saints, de nous l'offense ; l'église d'Azai sera profanée du même acte qui sanctifia l'arche et le temple de Jérusalem ! Nos curés, jusqu'à ce jour, étaient-il mécréants, hérétiques,
impies, ou prêtres catholiques, aussi sages pour le moins que des séminaristes ? Ils ont approuvé de tels plaisirs, et pris part à nos amusements, qui ne pouvaient scandaliser que les élèves du Picpus. Voilà quelques unes des raisons que nous opposons au trop de zèle de nos jeunes réformateurs.
Partant, vous déciderez, messieurs16, s'il ne serait pas convenable de nous rétablir dans le droit de danser, comme auparavant, sur la place d'Azai, les dimanches et les fêtes ; puis vous pourrez examiner s'il est temps d'obéir aux moines et d'apprendre des oraisons, lorsqu'on nous couche en joue de près, à bout touchant ; lorsqu'autour de nous toute l'Europe en armes fait l'exercice à feu, ses canons en batterie, et la mèche allumé.
[1] Armand de Ruzé comte d’Effiat était né le 6 septembre 1780. A cette époque, il était maire de la cité natale de Rabelais. Il remporta le scrutin du 10 mai 1822 avec 222 voix sur les 380 que comptait le collège électoral. Contemporain de Courier, Philippe-Emmanuel de Fehlemberg est un agronome suisse. Il a inventé un semoir.

|
[2] Il s’agit de notes que les ultras faisaient parvenir aux têtes pensantes de la Sainte-Alliance pour les informer de l’état de l’opinion en France. Elles partaient surtout de l’entourage du comte d’Artois.

|
[3] Rostopchine (1763-1826) fut le fameux gouverneur qui fit brûler Moscou pour que la Grande armée n’y reste pas. Installé à Paris en 1814, il y vécut jusqu’en 1823.

|
[4] Phrase tirée de Saint-Paul, 2e épître aux Corinthiens, III, 6.

|
[5] La Bruyère, Les Caractères, De l’Homme.

|
[6] Autrement dit depuis la Révolution qui a affranchi les hommes du peuple.

|
[7] Il s’agit du vieux curé Marchandeau, naguère vicaire épiscopal constitutionnel qui avait prêté serment à la Constitution et que Courier estimait. Il fut la victime des tracasseries du maire de Véretz, le hobereau parvenu de Beaune. Ce dernier se laissa même aller à frapper le vieux prêtre le 30 avril 1823, si violemment que le pauvre homme fut déséquilibré sous le coup et chuta sur le sol !

|
[8] Deux souverains pontifes sont ici évoqués : Boniface VIII, pape de 1294 à 1303 et Grégoire VII, alias Hildebrand, pape de 1073 à 1085. Le premier eut des démêlés avec Philippe le Bel, le second avec l’empereur d’Allemagne Henri IV, qui, au cœur de la querelle des Investitures dut s’humilier durant trois jours à Canossa.

|
[9] La rigueur imposée aux Trappistes est bien connue. Faut-il y voir une allusion à l’œuvre de réforme de la Trappe engagée un siècle et demi plus tôt par le seigneur de Véretz que fut l’abbé de Rancé ?

|
[10] La congrégation de Picpus, quartier de l’est de Paris, fut créée en 1601, par des religieux du tiers ordre de Saint-François.

|
[11] Dans l’édition originale, on lit « aux picpus ». Bien des éditions ultérieures ont imprimé à tort « au picpus ».

|
[12] Cette expression de « Dieu vomit les tièdes » n’est pas de saint Paul ; rendons à César ce qui appartient à César, elle se trouve dans l’Apocalypse de saint Jean, III, 16.

|
[13] Expression prise dans les Essais de Montaigne, livre III, chapitre VII.

|
[14] Vers tiré de l’Art poétique de Boileau, III, 202.

|
[15] Vers tiré du Tartuffe, acte I, scène 5.

|
[16] A l’origine, ce pamphlet se présentait comme devant être adressé à la Chambre des députés, comme le fut la Pétition de 1816. En fait, cette intention resta de pure forme, Courier ne voulant probablement pas prendre plus de risques qu’il ne fallait et aggraver son cas avec une assemblée gagnée aux idées ultramonarchistes.

|

|













 Introduction à la « Pétition pour des vill…
Introduction à la « Pétition pour des vill… 
 our avoir écrit le Simple discours, Courier purgea deux mois de prison à Sainte-Pélagie d’où il sortit le 9 décembre 1821. Dans l’esprit des juges, cette semonce allait l’amener à modérer ses attaques contre la Restauration. C’était mal connaître le « bonhomme Paul » prêt à « fronder un petit » à la première occasion. Le 10 mai 1822 eut lieu l’élection du député de l’arrondissement de Loches-Chinon. Courier fut le candidat, bien malgré lui, de l’opposition contre le candidat officiel
our avoir écrit le Simple discours, Courier purgea deux mois de prison à Sainte-Pélagie d’où il sortit le 9 décembre 1821. Dans l’esprit des juges, cette semonce allait l’amener à modérer ses attaques contre la Restauration. C’était mal connaître le « bonhomme Paul » prêt à « fronder un petit » à la première occasion. Le 10 mai 1822 eut lieu l’élection du député de l’arrondissement de Loches-Chinon. Courier fut le candidat, bien malgré lui, de l’opposition contre le candidat officiel 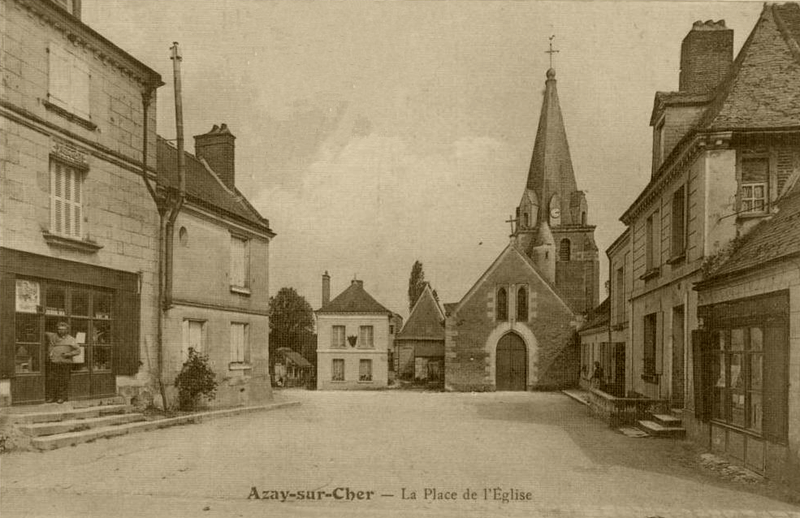 La place de l'église d'Azay-sur-cher
La place de l'église d'Azay-sur-cher 'objet de ma demande est plus important qu'il ne semble ; car bien qu'il ne s'agisse, au vrai, que de danse et d'amusements, comme d'une part ces amusements sont ceux du peuple, et que rien de ce qui le touche ne vous peut être indifférent ; que d'autre part, la religion s'y trouve intéressée ou compromise, pour mieux dire, par un zèle mal entendu, je pense, quelque peu d'accord qu'il puisse y avoir entre vous, que tous vous jugerez ma requête digne de votre attention.
'objet de ma demande est plus important qu'il ne semble ; car bien qu'il ne s'agisse, au vrai, que de danse et d'amusements, comme d'une part ces amusements sont ceux du peuple, et que rien de ce qui le touche ne vous peut être indifférent ; que d'autre part, la religion s'y trouve intéressée ou compromise, pour mieux dire, par un zèle mal entendu, je pense, quelque peu d'accord qu'il puisse y avoir entre vous, que tous vous jugerez ma requête digne de votre attention.

